Prof. Hajer Gueldich, Professeure agrégée en Droit international aux Universités de Carthage et de Kairouan- Tunisie
Membre élue de la Commission de l’Union africaine pour le Droit international (CUADI)
Bien que la Tunisie soit considérée comme un pays pionnier en matière de protection des droits des femmes dans le monde arabe, beaucoup de femmes restent victimes de discrimination dans de nombreux domaines et certaines sont soumises à tout genre de violence, comme le prouvent plusieurs statistiques et études nationales et internationales récentes, faites en la matière.
Si la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée en 1993 par l’Assemblée générale des Nations unies, atteste d’une reconnaissance internationale du fait que la violence à l’égard des femmes constitue une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, il n’y avait aucun texte spécifique aux violences familiales en Tunisie, avant la date du 26 juillet 2017.
En effet, en ce jour, une nouvelle loi intégrale (loi organique n°60-2016 du 26 juillet 2017) a été adoptée par l’Assemblée des Représentants du peuple, portant sur l’interdiction de la violence à l’égard des femmes et notamment sur les violences familiales, une loi dont l’idée remonte à 2006 mais qui a pu enfin se concrétiser en 2017, après un long combat initié par les associations et par la société civile tunisienne. Ce fut une étape décisive pour les droits des femmes en Tunisie.
Exigée par la société civile depuis des décennies et prescrite par la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014, selon laquelle « l’Etat s’engage à protéger les droits et les acquis de la femme et œuvre pour les développer (…). L’État prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence contre la femme» (article 46), l’élimination des violences à l’égard des femmes est maintenant un fait. C’est ainsi que la loi organique du 26 juillet 2017 a été votée à l’unanimité des députés présents, tous unis autour de l’idée que les violences contre les femmes ne sont pas des affaires d’ordre privé, mais elles concernent désormais l’Etat et que leur éradication est garante de la paix et de la sécurité de la société toute entière. Par ailleurs, il faut rappeler que la Tunisie est classée 19ème sur la liste des pays qui ont opté pour une loi intégrale contre la violence de genre et se distingue comme étant la première à l’échelle arabe et africaine.
A étudier ce texte de près, il est primordial de faire le bilan des acquis (1), mais aussi se pencher sur les défis et obstacles pouvant contrer la mise en œuvre effective de cette loi (2).
1) Les avancées juridiques relatives à cette loi
La loi organique contre la violence à l’égard des femmes se définit comme étant une loi intégrale, dans la mesure où elle englobe quatre volets aussi intrinsèques que complémentaires, à savoir la prévention, la protection et la prise en charge des victimes, d’une part, et la traduction en justice des agresseurs, de l’autre. En effet, cette loi comprend des éléments qui sont essentiels pour prévenir la violence à l’égard des femmes, protéger celles qui sont rescapées de violences familiales et traduire en justice les auteurs de ces abus.
En outre, le nouveau texte de loi définit la violence à l’égard des femmes comme « toute agression physique, morale, sexuelle ou économique contre une femme, basée sur une discrimination entre les sexes et lui infligeant des séquelles ou souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris le fait de la menacer d’une telle agression, d’exercer des pressions ou de la priver de ses droits et libertés, que ce soit dans la vie publique ou privée». Cette définition large contient les éléments clés pour définir la violence familiale, tels que recommandés par le Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes des Nations Unies.
Par ailleurs, cette nouvelle loi impliquera l’amendement de nombreux textes juridiques en vigueur en Tunisie : Code pénal, Code du Statut personnel, législation sur la protection de l’enfance, droit au travail, mais aussi droit à la santé.
A titre d’exemple, la loi introduit de nouvelles dispositions pénales et augmente les peines correspondant à diverses formes de violence lorsqu’elles sont commises dans le cadre familial. Elle pénalise aussi le harcèlement sexuel dans les lieux publics, l’emploi d’enfants comme employées domestiques et prévoit des amendes pour les employeurs qui discriminent intentionnellement les femmes au niveau des salaires.
Le texte contient aussi des mesures de prévention ; il ordonne au Ministère de la Santé de créer des programmes pour former le personnel médical aux méthodes de détection, d’évaluation et de prévention de la violence à l’égard des femmes et il prévoit de former les éducateurs aux exigences du droit tunisien et international en termes d’égalité, à la non-discrimination et aux façons de prévenir et de contrer la violence, afin de les aider à gérer les actes de violence dans les établissements scolaires.
En outre, la loi prévoit des mesures nécessaires pour assister les rescapées de violences familiales, notamment en leur fournissant un soutien juridique, médical et psychologique. Elle permet aux femmes de demander au tribunal une ordonnance de protection contre leurs agresseurs, sans même passer par une plainte au pénal ou une requête en divorce. Ces ordonnances peuvent, entre autres, exiger que l’auteur présumé de violence quitte le domicile ou qu’il se tienne à distance de la victime et de leurs enfants, ou encore lui interdire de commettre de nouvelles violences, d’émettre des menaces, d’endommager les biens de la victime ou de la contacter.
Enfin, la loi exige la création d’Unités de violences familiales au sein des Forces tunisiennes de sécurité intérieure, qui seront dédiées à la gestion des plaintes pour les violences au sein de la famille et la nomination, dans chaque gouvernorat, d’un procureur qui se consacrera à ce type d’affaires. Le nouveau texte établit aussi la responsabilité pénale de tout agent de cette unité spécialisée qui exercerait des pressions ou toute autre forme de coercition sur une femme pour la forcer à abandonner ou modifier sa plainte.
Par rapport à l’agresseur, cette nouvelle loi modifie certaines dispositions du Code pénal qui favorisaient l’impunité des auteurs. C’est un tournant majeur, en ce qu’elle reconnaît la notion de victime et met sa protection et la restitution de ses droits au cœur de ses préoccupations. Elle met fin à l’échappatoire honteuse permettant à l’agresseur sexuel de mineures de se soustraire aux poursuites en se mariant avec sa victime. Elle fait également de toutes les violences des crimes et délits d’ordre public, en particulier les violences dans le couple dont la notion a été élargie aux ex-conjoints, fiancés et ex-fiancés. Aussi, un devoir de signalement des violences pèse sur toute personne, y compris celle tenue par le secret professionnel, en cas de danger menaçant la victime.
De surcroît, longtemps dénié, l’inceste est nommément désigné. Il constitue une circonstance aggravante du viol et de l’attentat à la pudeur. De même, le consentement possible à un acte sexuel y a été élevé à l’âge de 16 ans alors qu’il était de 13 ans.
2) Les défis et obstacles quant à la mise en œuvre de cette loi
A compter de l’entrée en vigueur de ce texte, les femmes tunisiennes sont mieux protégées de toutes les formes de violence et les agresseurs tenus responsables de leurs actes.
Cette loi consacre, par voie de conséquence, une vision globale incluant prévention, protection et prise en charge des femmes exposées à toutes formes de violences physiques, morales, sexuelles, économiques ou politiques.
Cependant, un certain nombre de défis doivent être contrecarrés, afin de pouvoir faciliter la mise en œuvre effective de cette nouvelle loi. En effet, des contraintes d’ordre politique, financier, socioculturel, peuvent minimiser l’impact de cette loi tant attendue.
D’une part, et relativement aux institutions et organismes qu’il faut créer pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, il faudrait que les autorités tunisiennes s’assurent qu’il existe les fonds suffisants et la volonté politique indispensable pour mettre en place les institutions qui permettront de traduire cette loi en véritable protection et assurer la formation du personnel compétent pour ce genre de dossiers. De même, alors que la loi demande aux autorités d’adresser les femmes à des refuges si elles en ont besoin, elle ne prévoit aucun mécanisme pour leur financement, que ce soit pour les refuges gouvernementaux ou ceux gérés par des associations. Elle ne présente aucune disposition pour permettre au gouvernement de fournir aux femmes qui en ont besoin un soutien financier rapide ou une assistance pour trouver un hébergement à long terme. En gros, la loi ne stipule pas comment l’État pourra financer les programmes et les mesures qu’elle met en place.
D’autre part, et pour que la loi entre pleinement en vigueur et que les discriminations envers les femmes soit éliminées, il faut s’assurer qu’il existe une réelle volonté politique de la part des autorités compétentes pour bien appliquer les règles, mais aussi faire évoluer les mentalités des Tunisiens et faire cesser les discriminations à l’égard des femmes, tout en mettant l’accent sur les bienfaits des retombées de cette loi sur le milieu familial et sur la société.
Les femmes subissent des taux élevés de violence familiale en Tunisie, dans le cadre familial mais aussi ailleurs. Le texte, entré en vigueur, permettra certainement de faire des avancées notables dans le cadre de la prévention de la violence à l’égard des femmes.
A part cela, il reste que la sensibilisation des femmes tunisiennes quant à leurs droits est d’une importance cruciale afin de bien faire évaluer les mentalités et aspirer à de meilleures pratiques en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes, un sujet tabou qui reste encore marginalisé et qui fait toujours partie du non-dit. Cette sensibilisation devra toucher un public très large, allant des écoles, aux lycées, facultés, médias, centres médicaux et centres de soins, centres de planning familial, milieux de travail, etc. Ces campagnes de sensibilisation et de communication auront un rôle énorme afin d’éclairer les femmes et les jeunes filles par rapport à leurs droits. Mais le travail de prévention et de sensibilisation passe aussi par la culture et l’art dans toutes ses formes (théâtre, musique, danse, peinture, cinéma, etc.). L’art a toujours eu cette fonction de casser les tabous, d’ouvrir les mentalités et les esprits.
En conclusion, il est indéniable que la loi intégrale interdisant la violence à l’égard des femmes en Tunisie constitue une pierre de plus, ajoutée aux fondations de la Tunisie démocratique. Cette loi est venue bouleverser des dogmes que l’on a cru dépassés, société patriarcale, domination masculine, devoir d’obéissance imposé aux femmes, tout un référentiel sociologique, idéologique et culturel bâti sur la discrimination. Faire changer les mentalités, dépasser les résistances au changement et faire évoluer la société nécessite du temps. Mais le combat continue pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, pour la réforme des textes en vigueur et pour reconnaître enfin un statut de dignité aux femmes tunisiennes.


Last Updated: 5 décembre 2018 by Webmaster
Rapport d’activités CEJA 2017
Téléchargez le Rapport d’activités CEJA 2017!
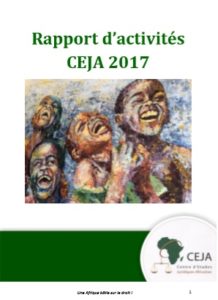
Last Updated: 3 septembre 2018 by Webmaster
Participation du CEJA à l’Université d’été de l’Université libre de Bruxelles, Belgique
Du 27 au 28 août 2018, le CEJA a été invité à prendre part à la première édition de l’Université d’été Contrôle des lieux privatifs de liberté : approche pluridisciplinaire organisé par la Faculté de droit et criminologie de l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Le Directeur exécutif du CEJA est intervenu sur deux thématiques, à savoir : le droit régional africain et les législations pénitentiaires africaines.
Last Updated: 13 juillet 2018 by Webmaster
Allocutions de nos stagiaires à la 38ème session du Conseil des droits de l’homme – Genève Juin/Juillet 2018
Allocution de Mlle Shannon Valentino sur le Burundi à la 38ème session du Conseil des droits de l’homme, Genève, 27 juin 2018
Panel Discussion on the Impact of Violence against Women – 11th Meeting, 38th Regular Session Human Rights Council
Allocution de Mlle Laura Martins sur la République Centrafricaine à la 38ème session du Conseil des droits de l’homme – Genève, le 4 juillet 2018
Allocution de Mlle Laura Morel sur la discrimination à l’égard des femmes à la 38ème session du Conseil des droits de l’Homme – Genève, le 21 Juin 2018
Allocution de Ms. Laura Martins, Espace Afrique International,à la 38ème session du Conseil des droits de l’homme – Genève le 20 juin 2018
Last Updated: 29 juillet 2018 by Webmaster
Accueil de nouveaux stagiaires du Master Droit des Libertés de la Faculté de droit de l’Université de Caen
Dans le cadre de sa coopération avec le monde académique, le CEJA accueille cette année trois stagiaires, étudiantes en Master Droit des Libertés de la Faculté de droit de l’Université de Caen, Normandie (France). Ce stage de 2 mois leur permettra de s’imprégner du rôle de la société civile et du Groupe africain lors des sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.
Mademoiselle Laura Martins est titulaire d’une licence en droit obtenue à l’université de Bretagne Occidentale, à Brest en France. Elle a ensuite continué son cursus en s’orientant d’abord vers le domaine des carrières judicaires et sciences criminelles, puis vers un Master en droit international et européen obtenu à l’université d’Aix en Provence, en France. Elle termine cette année un Master II en Droit des Libertés à l’université de Caen Normandie, en France, et dans ce cadre, elle effectue actuellement un stage au sein du CEJA. Particulièrement intéressée par le droit international humanitaire et le droit international pénal, elle a ainsi rejoint l’organisation STAND France, qui se mobilise contre les génocides et la violence de masse. Laura est également passionnée par le droit des femmes et envisage de travailler à l’international dans le domaine de la protection des droits des femmes.
Mademoiselle Laura Morel est titulaire d’une licence de droit Parcours droit bilingue anglo-américain de l’Université du Havre, en France. Après sa licence, elle a obtenu un Master 1 Droits fondamentaux à l’Université de Caen, Normandie et elle est en train de finir son Master 2 Droit des Libertés au sein de la même Université. Dans le cadre de ce Master, Laura Morel participe au projet de la Clinique Juridique des Droits Fondamentaux de Caen qui porte sur le droit de la santé pour les femmes atteintes par le cancer du sein au Togo. Elle effectue actuellement un stage au sein du Centre d’Études Juridiques Africaines. Passionnée, des droits de l’Homme, elle ambitionne de travailler dans ce domaine.
Mademoiselle Shannon Valentino est titulaire d’une licence de droit de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en -Yvelines et d’un Master 1 Droits fondamentaux de l’Université de Caen, Normandie. Elle est en train de finir son Master 2 Droit des libertés au sein de la Faculté de droit de l’Université de Caen. Elle effectue également un stage académique au CEJA. Son intérêt se porte tout particulièrement sur les domaines du droit international des droits de l’Homme et le droit des femmes.
Last Updated: 8 juin 2018 by Webmaster
Cours sur la migration et la bonne gouvernance en Afrique à l’intention des diplomates Guinéens, 21 mai 2018
Le 21 mai 2018, le directeur exécutif du CEJA a animé un cours sur Le rôle de l’Etat et le principe de séparation des pouvoirs dans le cadre de la formation sur la Construction de l’Etat organisé par le Geneva Centre for Security Policy (GCSP).
Last Updated: 18 juillet 2018 by Webmaster
Participation à la 38ème session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du 18 juin au 6 juillet 2018
Depuis le 18 juin 2018, le CEJA prend part à la 38ème session du Conseil des droits de l’homme avec des interventions orales sur la situation des droits de l’homme en Afrique, notamment sur le Burundi, le République Centrafricaine et la République Démocratique du Congo.
Lire les interventions:
Last Updated: 23 avril 2018 by Webmaster
Rencontre avec le Président de la République Centrafricaine
Le 27 septembre 2017, une délégation du CEJA a pu rencontrer son Excellence le Prof. Faustin Archange Touadéra, Président de la République Centrafricaine, lors de son passage à Genève durant la 36ème session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.
Last Updated: 23 avril 2018 by Webmaster
Adoption de la loi organique pour l’élimination des violences de genre en Tunisie
Prof. Hajer Gueldich, Professeure agrégée en Droit international aux Universités de Carthage et de Kairouan- Tunisie
Membre élue de la Commission de l’Union africaine pour le Droit international (CUADI)
Bien que la Tunisie soit considérée comme un pays pionnier en matière de protection des droits des femmes dans le monde arabe, beaucoup de femmes restent victimes de discrimination dans de nombreux domaines et certaines sont soumises à tout genre de violence, comme le prouvent plusieurs statistiques et études nationales et internationales récentes, faites en la matière.
Si la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée en 1993 par l’Assemblée générale des Nations unies, atteste d’une reconnaissance internationale du fait que la violence à l’égard des femmes constitue une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, il n’y avait aucun texte spécifique aux violences familiales en Tunisie, avant la date du 26 juillet 2017.
En effet, en ce jour, une nouvelle loi intégrale (loi organique n°60-2016 du 26 juillet 2017) a été adoptée par l’Assemblée des Représentants du peuple, portant sur l’interdiction de la violence à l’égard des femmes et notamment sur les violences familiales, une loi dont l’idée remonte à 2006 mais qui a pu enfin se concrétiser en 2017, après un long combat initié par les associations et par la société civile tunisienne. Ce fut une étape décisive pour les droits des femmes en Tunisie.
Exigée par la société civile depuis des décennies et prescrite par la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014, selon laquelle « l’Etat s’engage à protéger les droits et les acquis de la femme et œuvre pour les développer (…). L’État prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence contre la femme» (article 46), l’élimination des violences à l’égard des femmes est maintenant un fait. C’est ainsi que la loi organique du 26 juillet 2017 a été votée à l’unanimité des députés présents, tous unis autour de l’idée que les violences contre les femmes ne sont pas des affaires d’ordre privé, mais elles concernent désormais l’Etat et que leur éradication est garante de la paix et de la sécurité de la société toute entière. Par ailleurs, il faut rappeler que la Tunisie est classée 19ème sur la liste des pays qui ont opté pour une loi intégrale contre la violence de genre et se distingue comme étant la première à l’échelle arabe et africaine.
A étudier ce texte de près, il est primordial de faire le bilan des acquis (1), mais aussi se pencher sur les défis et obstacles pouvant contrer la mise en œuvre effective de cette loi (2).
1) Les avancées juridiques relatives à cette loi
La loi organique contre la violence à l’égard des femmes se définit comme étant une loi intégrale, dans la mesure où elle englobe quatre volets aussi intrinsèques que complémentaires, à savoir la prévention, la protection et la prise en charge des victimes, d’une part, et la traduction en justice des agresseurs, de l’autre. En effet, cette loi comprend des éléments qui sont essentiels pour prévenir la violence à l’égard des femmes, protéger celles qui sont rescapées de violences familiales et traduire en justice les auteurs de ces abus.
En outre, le nouveau texte de loi définit la violence à l’égard des femmes comme « toute agression physique, morale, sexuelle ou économique contre une femme, basée sur une discrimination entre les sexes et lui infligeant des séquelles ou souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris le fait de la menacer d’une telle agression, d’exercer des pressions ou de la priver de ses droits et libertés, que ce soit dans la vie publique ou privée». Cette définition large contient les éléments clés pour définir la violence familiale, tels que recommandés par le Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes des Nations Unies.
Par ailleurs, cette nouvelle loi impliquera l’amendement de nombreux textes juridiques en vigueur en Tunisie : Code pénal, Code du Statut personnel, législation sur la protection de l’enfance, droit au travail, mais aussi droit à la santé.
A titre d’exemple, la loi introduit de nouvelles dispositions pénales et augmente les peines correspondant à diverses formes de violence lorsqu’elles sont commises dans le cadre familial. Elle pénalise aussi le harcèlement sexuel dans les lieux publics, l’emploi d’enfants comme employées domestiques et prévoit des amendes pour les employeurs qui discriminent intentionnellement les femmes au niveau des salaires.
Le texte contient aussi des mesures de prévention ; il ordonne au Ministère de la Santé de créer des programmes pour former le personnel médical aux méthodes de détection, d’évaluation et de prévention de la violence à l’égard des femmes et il prévoit de former les éducateurs aux exigences du droit tunisien et international en termes d’égalité, à la non-discrimination et aux façons de prévenir et de contrer la violence, afin de les aider à gérer les actes de violence dans les établissements scolaires.
En outre, la loi prévoit des mesures nécessaires pour assister les rescapées de violences familiales, notamment en leur fournissant un soutien juridique, médical et psychologique. Elle permet aux femmes de demander au tribunal une ordonnance de protection contre leurs agresseurs, sans même passer par une plainte au pénal ou une requête en divorce. Ces ordonnances peuvent, entre autres, exiger que l’auteur présumé de violence quitte le domicile ou qu’il se tienne à distance de la victime et de leurs enfants, ou encore lui interdire de commettre de nouvelles violences, d’émettre des menaces, d’endommager les biens de la victime ou de la contacter.
Enfin, la loi exige la création d’Unités de violences familiales au sein des Forces tunisiennes de sécurité intérieure, qui seront dédiées à la gestion des plaintes pour les violences au sein de la famille et la nomination, dans chaque gouvernorat, d’un procureur qui se consacrera à ce type d’affaires. Le nouveau texte établit aussi la responsabilité pénale de tout agent de cette unité spécialisée qui exercerait des pressions ou toute autre forme de coercition sur une femme pour la forcer à abandonner ou modifier sa plainte.
Par rapport à l’agresseur, cette nouvelle loi modifie certaines dispositions du Code pénal qui favorisaient l’impunité des auteurs. C’est un tournant majeur, en ce qu’elle reconnaît la notion de victime et met sa protection et la restitution de ses droits au cœur de ses préoccupations. Elle met fin à l’échappatoire honteuse permettant à l’agresseur sexuel de mineures de se soustraire aux poursuites en se mariant avec sa victime. Elle fait également de toutes les violences des crimes et délits d’ordre public, en particulier les violences dans le couple dont la notion a été élargie aux ex-conjoints, fiancés et ex-fiancés. Aussi, un devoir de signalement des violences pèse sur toute personne, y compris celle tenue par le secret professionnel, en cas de danger menaçant la victime.
De surcroît, longtemps dénié, l’inceste est nommément désigné. Il constitue une circonstance aggravante du viol et de l’attentat à la pudeur. De même, le consentement possible à un acte sexuel y a été élevé à l’âge de 16 ans alors qu’il était de 13 ans.
2) Les défis et obstacles quant à la mise en œuvre de cette loi
A compter de l’entrée en vigueur de ce texte, les femmes tunisiennes sont mieux protégées de toutes les formes de violence et les agresseurs tenus responsables de leurs actes.
Cette loi consacre, par voie de conséquence, une vision globale incluant prévention, protection et prise en charge des femmes exposées à toutes formes de violences physiques, morales, sexuelles, économiques ou politiques.
Cependant, un certain nombre de défis doivent être contrecarrés, afin de pouvoir faciliter la mise en œuvre effective de cette nouvelle loi. En effet, des contraintes d’ordre politique, financier, socioculturel, peuvent minimiser l’impact de cette loi tant attendue.
D’une part, et relativement aux institutions et organismes qu’il faut créer pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, il faudrait que les autorités tunisiennes s’assurent qu’il existe les fonds suffisants et la volonté politique indispensable pour mettre en place les institutions qui permettront de traduire cette loi en véritable protection et assurer la formation du personnel compétent pour ce genre de dossiers. De même, alors que la loi demande aux autorités d’adresser les femmes à des refuges si elles en ont besoin, elle ne prévoit aucun mécanisme pour leur financement, que ce soit pour les refuges gouvernementaux ou ceux gérés par des associations. Elle ne présente aucune disposition pour permettre au gouvernement de fournir aux femmes qui en ont besoin un soutien financier rapide ou une assistance pour trouver un hébergement à long terme. En gros, la loi ne stipule pas comment l’État pourra financer les programmes et les mesures qu’elle met en place.
D’autre part, et pour que la loi entre pleinement en vigueur et que les discriminations envers les femmes soit éliminées, il faut s’assurer qu’il existe une réelle volonté politique de la part des autorités compétentes pour bien appliquer les règles, mais aussi faire évoluer les mentalités des Tunisiens et faire cesser les discriminations à l’égard des femmes, tout en mettant l’accent sur les bienfaits des retombées de cette loi sur le milieu familial et sur la société.
Les femmes subissent des taux élevés de violence familiale en Tunisie, dans le cadre familial mais aussi ailleurs. Le texte, entré en vigueur, permettra certainement de faire des avancées notables dans le cadre de la prévention de la violence à l’égard des femmes.
A part cela, il reste que la sensibilisation des femmes tunisiennes quant à leurs droits est d’une importance cruciale afin de bien faire évaluer les mentalités et aspirer à de meilleures pratiques en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes, un sujet tabou qui reste encore marginalisé et qui fait toujours partie du non-dit. Cette sensibilisation devra toucher un public très large, allant des écoles, aux lycées, facultés, médias, centres médicaux et centres de soins, centres de planning familial, milieux de travail, etc. Ces campagnes de sensibilisation et de communication auront un rôle énorme afin d’éclairer les femmes et les jeunes filles par rapport à leurs droits. Mais le travail de prévention et de sensibilisation passe aussi par la culture et l’art dans toutes ses formes (théâtre, musique, danse, peinture, cinéma, etc.). L’art a toujours eu cette fonction de casser les tabous, d’ouvrir les mentalités et les esprits.
En conclusion, il est indéniable que la loi intégrale interdisant la violence à l’égard des femmes en Tunisie constitue une pierre de plus, ajoutée aux fondations de la Tunisie démocratique. Cette loi est venue bouleverser des dogmes que l’on a cru dépassés, société patriarcale, domination masculine, devoir d’obéissance imposé aux femmes, tout un référentiel sociologique, idéologique et culturel bâti sur la discrimination. Faire changer les mentalités, dépasser les résistances au changement et faire évoluer la société nécessite du temps. Mais le combat continue pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, pour la réforme des textes en vigueur et pour reconnaître enfin un statut de dignité aux femmes tunisiennes.
Last Updated: 5 juillet 2018 by Webmaster
Quelques réflexions sur la crise politique au Togo
Abdoulaye Nazaire Gnienhoun, Juriste, Chargé de projet ONU et Union Africaine
Depuis quelques semaines, l’opinion africaine et internationale suit avec intérêt la situation politique au Togo. D’impressionnantes marrées humaines, structurées autour d’organisations de la société civile et de l’opposition togolaises, réclament au Président Faure Gnassingbé des réformes constitutionnelles substantielles dont la principale est le retour à la version de la constitution de 1992 qui limitait sans équivoque à deux mandats l’exercice de la fonction présidentielle. L’ambigüité manifeste du nouveau texte est perçue comme une tentative de contourner cette limitation afin de permettre au président actuel de briguer deux autres mandats supplémentaires.
On peut naturellement déduire que l’objectif clairement affiché de ces manifestations est de réunir les garanties d’une alternance politique à la tête du pays en 2020 quand le Président actuel aura alors achevé son dernier mandat et passé 15 ans au pouvoir. Des reformes donc, qui, si elles parvenaient à aboutir excluraient ipso jure ce dernier de la course à la conquête de la magistrature suprême.
On a compris depuis un certain moment que les populations africaines devenaient de plus en plus hostiles à l’exercice du pouvoir à vie ou de modifications constitutionnelles à cette fin.
A y voir de près, la crise togolaise est une bonne nouvelle pour le continent (1). Elle met le Président Faure Gnassingbé devant sa responsabilité historique vis-à-vis de son peuple et de son pays (2) et il faut vivement espérer que les institutions sous régionales et continentales, notamment la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Africaine, ne ratent pas cette occasion pour peser de leurs poids afin que le Togo ne sombre pas dans le chaos (3).
1. Les manifestations populaires togolaises : une « bonne nouvelle » pour le continent africain
Il ne s’agit nullement d’être cynique au point de se réjouir d’une crise politique dans un pays, loin de là ! Toutefois, les manifestions en cours, au-delà des victimes et de leur impact sur l’image du pays, ont un aspect réjouissant dans le fait que nous sommes en train d’assister peut-être au crépuscule d’une pratique, celle des présidences à vie et des constitutions « charcutées » selon la volonté du Prince qui ont malheureusement conduit à des bains de sang, désolations et ruines sur le continent africain ces trente dernières années. Durant toutes ces décennies, les manipulations constitutionnelles pour rester au pouvoir étaient devenues presque une règle et monnaie courante. De ce point de vue, on peut apprécier à sa juste valeur l’évolution des mentalités africaines car la tendance actuelle à la résistance contre de telles velléités de changements intempestifs des textes constitutionnels démontre clairement une avancée, un changement de paradigme sur le continent qui aspire de plus en plus, à travers surtout sa jeunesse, à une gouvernance démocratique effective, gage de développement de l’Afrique d’aujourd’hui et de demain. Les choses bougent donc, et comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner, des secousses politiques d’une telle « magnitude » à l’exemple de celles du Burkina Faso, il y a 3 ans, de la Gambie en début d’année et celles en cours au Togo sont absolument indispensables et surtout souhaitables pour contraindre nos systèmes politiques et nos jeunes démocraties à plus de dégourdissement, à plus d’ingénierie et d’hygiène politiques.
A cet égard, la crise togolaise offre d’heureuses perspectives pour tourner la page d’un système et d’un mode de gouvernance qui n’ont pas réussi à faire leurs preuves en presque 50 ans d’exercice exclusif du pouvoir. Combien de temps faudra-t-il encore attendre ? Cela dépendra naturellement du sens de la responsabilité du Président Faure Gnassingbé.
2) La responsabilité historique du Président Faure Gnassingbé face à son pays et à son peuple
Le Président Faure Gnassingbé est à mi-parcours puisque son mandat actuel ne devrait prendre fin qu’en 2020 et l’on peut comprendre qu’il puisse prétendre le conduire à son terme. Cependant, cette prétention dépendra largement de la façon dont il gérera la crise actuelle. Il se trouve donc devant une responsabilité historique qui déterminera l’avenir du Togo. D’anciens chefs d’État, comme le Burkinabè Blaise Compaoré, le Gambien Yaya Jammeh, pour ne citer que ces deux, avaient eu la même responsabilité – voire la chance- de se transcender en hommes d’Etat. Mais ils ont raté le coche. La fin tragico-comique de leur régime est suffisamment éloquente et édifiante à ce propos.
Ceci étant, et la raison aidant, il est à souhaiter que le Président Faure Gnassingbé considère à leur juste valeur les aspirations des Togolais et entérine le fait que 2020 est et doit être l’année de la fin de son règne en tant que Président du Togo. Ce serait une grande preuve de courage et de réalisme politique qui lui vaudra sans doute un sort beaucoup plus digne au moment de quitter la tête du pays. Il a donc l’immense opportunité d’entrée dans l’histoire togolaise et africaine par la grande porte.
Pour ce faire, sa démarche devrait cependant être entière, sans faux calculs politiciens et agenda caché. Elle devrait résulter d’une décision définitive, personnelle qui ferait de lui un homme d’Etat visionnaire rompant avec les pratiques de son père.
Il est également à souhaiter qu’il manifeste clairement et publiquement son intention de ne plus briguer un troisième mandat. Pour cela, il devra répondre positivement aux aspirations de respect des dispositions constitutionnelles de 1992 exprimées par l’opposition, la société civile et le clergé togolais.
Se réfugier dans une logique répressive des manifestants avec son cortège de morts et surtout s’arc-bouter à ne pas céder juste un « bout de phrase » dans les réformes constitutionnelles souhaitées c’est hélas, à notre sens, augmenter les risques de tomber dans la catégorie des « malaimés » de la démocratie africaine et de fuir le Togo « en plein midi » comme l’on dit sous nos tropiques et de se destiner à une vie d’exilé avec le remords éternel d’être le rebut de l’histoire.
Mais au-delà des aspirations du peuple togolais, la crise contient une dimension régionale et continentale exigeant que les institutions sous régionale et continentale que sont la CEDEAO et l’Union Africaine s’y investissent et surtout qu’elles saisissent l’occasion pour démontrer leur réelle volonté à respecter les aspirations des populations africaines et les textes panafricains relatifs à la gouvernance et à la démocratie adoptés dans leurs cadres spécifiques.
3) La nécessité pour la CEDEAO et l’Union Africaine de prendre des positions claires
Le silence constaté ou la timidité dans les réactions aux niveaux régional et continental laisse perplexe au regard de l’enjeu tant démocratique que sécuritaire. L’on serait presque tenté de dire que ces institutions laissent échapper de sérieuses occasions pour affirmer leurs autorités communautaires et réaffirmer fermement leurs principes et normes intangibles en matière de démocratie et de bonne gouvernance. La timide réaction des institutions africaines renforce malheureusement l’impression qu’elles ne sont que des caisses de résonance des dirigeants africains plus versées dans des considérations diplomatiques et coupées des aspirations réelles des populations.
Les institutions africaines gagneraient à se rattraper en s’impliquant davantage dans cette crise togolaise appelée à connaître d’autres développements pour que le Togo ne sombre pas dans un chaos total prévisible. Un tel « rattrapage » est possible sous une double condition.
La première condition est relative à la volonté des institutions africaines de se ranger du côté des peuples africains et de leurs aspirations. Elles se doivent d’agir en faveur d’une perception et d’une interprétation normatives conformes aux idéaux contenus dans leurs textes fondateurs.
La seconde condition porte sur l’affirmation effective de l’autorité de ces institutions qui ont intérêt à être fermes et intransigeantes sur les valeurs démocratiques intangibles et non négociables qui s’imposent à tous, notamment aux gouvernements africains qui malheureusement se montrent peu soucieux des intérêts et des aspirations de leurs peuples. Elles gagneraient énormément, à n’en pas douter, en crédibilité et ne seraient pas perçues comme de simples « clubs ou confréries » de chefs d’Etats africains ou de simples coquilles vides.
A ce titre, la CEDEAO et l’Union africaine devraient s’inspirer de la Cour suprême du Kenya pour contribuer réellement aux niveaux régional et continental à l’édification d’une Afrique fondée sur le droit.
Last Updated: 7 juin 2018 by Webmaster
Cours aux diplomates africains dans les sessions de formation de la Geneva Centre for Security Policy
CAMEROUN
Cours aux diplomates Camerounais, promotion 2017
Le 12 décembre 2017, Dr Ghislain Patrick Lessène, Directeur exécutif du CEJA, a animé une session de formation organisée par le Geneva Center for Security Policy (GCSP) à l’intention des diplomates Camerounais. La formation, qui portait sur “ la bonne gouvernance et la migration pour diplomates camerounais ”, a été l’occasion d’analyser les « Systèmes politiques nationaux » et leurs liens avec la bonne gouvernance et la migration. Le Directeur exécutif du CEJA a mis l’accent sur la nécessité pour l’Afrique de se doter de systèmes politiques nationaux solides fondés sur l’intérêt général et des institutions républicaines fiables et déterminées pour prévenir les conflits, source de flux migratoires de la population africaine. Le cours a donné lieu à d’intenses échanges interactifs sur l’état de lieux démocratique du continent de ces dernières années ainsi qu’à l’analyse du rôle moteur que le Cameroun joue actuellement dans la stabilité de l’Afrique centrale.
Actualités et articles